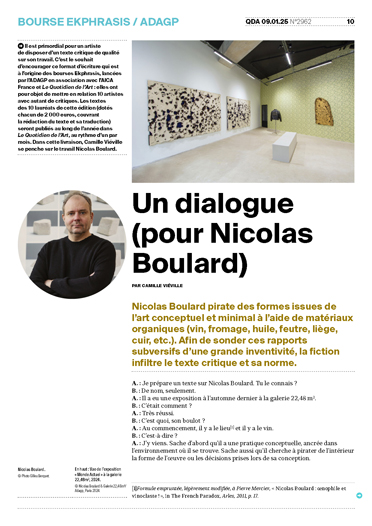Un dialogue
(pour Nicolas Boulard)
Par Camille Viéville
Nicolas Boulard pirate des formes issues de l’art conceptuel et minimal à l’aide de matériaux organiques (vin, fromage, huile, feutre, liège, cuir, etc.). Afin de sonder ces rapports subversifs d’une grande inventivité, la fiction infiltre le texte critique et sa norme.
A. : Je prépare un texte sur Nicolas Boulard. Tu le connais ?
B. : De nom, seulement.
A. : Il a eu une exposition à l’automne dernier à la Galerie 22,48 m2.
B. : C’était comment ?
A. : Très réussi.
B. : C’est quoi, son boulot ?
A. : Au commencement, il y a le lieu1 et il y a le vin.
B. : C’est-à-dire ?
A. : J’y viens. Sache d’abord qu’il a une pratique conceptuelle, ancrée dans l’environnement où il se trouve. Sache aussi qu’il cherche à pirater de l’intérieur la forme de l’œuvre ou les décisions prises lors de sa conception.
B. : Exactement ce que recommande McKenzie Wark dans Un Manifeste Hacker : hacker pour encourager des formes nouvelles, pas toujours de grandes choses, pas même de bonnes choses, mais de nouvelles choses2 .
A. : Tu l’as lu ?
B. : Tu plaisantes ? J’ai arrêté la fac à cause de ce bouquin.
A. : « L’éducation enchaîne l’esprit3»… J’ignorais que Wark avait eu une telle influence sur toi. Donc : Boulard hacke l’histoire de l’art et son propre travail. Il considère l’espace de liberté né de la rencontre d’une norme et d’un élément perturbateur. Par exemple, l’analogie entre les principales formes de fromages et celles de l’art minimal (le cube, le cylindre, la pyramide) lui inspire Specific Cheeses (2010). Il conçoit douze moules à fromage d’après Twelve Forms Derived from a Cube (1984) de Sol LeWitt, qu’il propose à des producteurs. Un dialogue s’engage entre l’artiste et chaque producteur de fromage – Boulard appelle cela une situation.
B. : Un dialogue ? Un fromage est un fromage.
A. : Détrompe-toi. Le changement de moule modifie le rapport surface/volume. On touche non seulement à la forme mais aussi au goût du fromage car la freinte est différente avec chacun des moules.
B. : Qu’est-ce que c’est que ça, la freinte ?
A. : La perte de matière pendant l’affinage. Specific Cheeses est la rencontre entre une norme – ici, la géométrie du producteur – et un élément perturbateur – là, la géométrie de l’artiste. Or, il y a plus. Le fromage en tant que matière organique hacke de l’intérieur le dogme géométrique. Le mou subvertit le dur ! On assiste à une double libération, de la norme fromagère ET de la norme minimale, d’autant qu’une fois démoulé et affiné, un fromage, surtout s’il est à pâte molle, continue de se transformer. C’est le cas dans les Specific Cheeses que produit Boulard : la forme varie, elle est instable. Et à mesure que le fromage mûri, elle s’effondre…
B. : Tu veux dire que Boulard est un sceptique ?
A. : Voilà qui ne m’étonnerait pas ! Mais d’un scepticisme fécond. Ça me fait penser à une autre de ses œuvres, Mort sur place, un blouson de cuir clouté – « Mort sur place » étant l’anagramme de Marcel Proust. Curieux, pour une star de la littérature qui à la fin ne sortait plus de sa chambre, non ? La subversion et l’humour noir dont Boulard fait preuve ont valeur de résistance. Créer, c’est résister.
B. : Et inversement4.
A. : En effet, ça fonctionne dans les deux sens5 ! Pour en revenir au fromage, le terme « effondrement » revient beaucoup dans les textes, les siens, qu’il publie à l’enseigne des « éditions de Dés ».
B. : « Un coup de dé jamais n’abolira le hasard ».
A. : Tout juste. Sans oublier que le dé est un cube… Souviens-toi, au commencement, il y a le lieu. Il écrit essentiellement en résidence, depuis un lieu précis et durant un temps déterminé.
B. : Bon, et le vin ?
A. : Le vin est comme le fromage, une matière vivante codifiée par une norme. Avant de travailler sur le fromage, Boulard s’intéresse au vin. Au cours des années 2000, dans plusieurs projets, il hacke les règles explicites et implicites du monde vinicole, jusqu’à l’absurde.
B. : C’est pas clair ce que tu dis. T’as pas un exemple ?
A. : Si, si, bien sûr : Grands Crus de Grand Cru (2004). Sur la route des vins d’Alsace, Boulard sélectionne cinquante grands crus qu’il mélange ensuite pour composer ce qui devrait être le vin ultime6. Quelque chose déraille de l’intérieur. Détournée de la sorte, la norme implose. En 2024, Boulard revient au vin, enfin, au « vin aigre », capable selon la tradition médiévale de combattre la bile noire. Il réalise Nuancier (Remède à la mélancolie), cent cinquante bouteilles de vinaigre coloré selon le nuancier officiel du rosé, qui étrangement s’étend du violet au jaune citron.
B. : When minimal goes pop… Et qu’est-ce qu’il présentait à la galerie ?
A. : Boulard travaille souvent sur le lieu, l’environnement, le territoire, la marge. Pour cette exposition, il a également travaillé sur le temps. À propos du temps, McKenzie Wark, qu’on évoquait tout à l’heure, écrit – attends, je l’ai noté sur mon téléphone : « Une histoire hacker ne connaît que le temps présent7. » Or Boulard a donné pour titre à son expo, et au petit livre qui l’accompagne, Monde actuel. C’est l’anagramme de Claude Monet, que l’artiste cloute, comme dans Mort sur place, sur un blouson de cuir.
B. : Qu’est-ce que tu racontes ? Ça va faire cent ans que Monet est mort. On a vu plus actuel !
A. : Ce que tu peux être prosaïque, parfois. Il y a des artistes pour toujours actuels, tu devrais le savoir… Songe à Impression. Soleil levant, aux Meules, aux Cathédrales de Rouen, aux Nymphéas. Autant de tableaux de Monet qui saisissent un instant éphémère – un rayon de soleil sur la mer, les ombres dessinées dans un champ par un cône de paille (forme minimale s’il en est !), etc. Paradoxalement, des tableaux qui, tout en ayant pour objet un moment fugace, ont traversé l’histoire de la modernité et fait de Monet une star. Boulard, dans le livre, remarque – ça aussi je l’ai noté : « Le monde actuel est une mécanique organique qui ne s’arrête pas8. » Comme la fermentation du pain, la moisissure du stilton, la pourriture noble du sauternes. Étant entendu, évidemment, qu’une œuvre est une étape, une transition vers une autre œuvre. Pour se confronter à Monet et à son mythe, il provoque de nouveau une situation. Il échange avec lui, il l’actualise. Ainsi, à la galerie étaient exposées des tapisseries en feutre de la série Penicillium (2019), à la fois abstraites et réalistes : une plongée non pas dans le bassin des nymphéas mais dans un pain de roquefort. On pouvait également découvrir Pains (2024), constitués de contreplaqué teint au brou de noix. Chaque tranche est monumentale puisqu’elle mesure 1,5 mètres de haut. Ces Pains sont hiératiques à la manière des Cathédrales de Monet – avec une mie pareille à une façade sculptée –, semblables et pourtant tous distincts. Et puis il y avait deux paysages récents, détournés du réel, Giverny, terre prélevée dans le champ des Meules, séchée et glissée dans un cadre (ça me rappelle une pièce de la série Non-Site de Robert Smithson en 1968, faite de boue ramassée à Essen) et surtout Soleil levant – Le Havre. Boulard enchâsse de l’eau puisée dans le port du Havre entre deux plaques de verre pour former un tableau vivant où buée et microorganismes se développent ou régressent au gré des conditions extérieures. Il procède ici à un triple hacking. Il pirate la peinture comme médium, il pirate le tableau comme surface plane et il pirate le paysage de Monet, imaginant un espace en mouvement perpétuel, un espace perpétuellement d’actualité.
B. : Dans ton texte, tu parleras de tout ça ?
A. : Oui, de toutes ces strates en continuelle maturation qui, assemblées, engendrent des formes neuves et passagères9…
Notes
1 Formule empruntée, légèrement modifiée, à Pierre Mercier, « Nicolas Boulard : œnophile et vinoclaste ! », in The French Paradox, Arles, 2011, p. 17.
2 Cf. McKenzie Wark, Un Manifeste Hacker (2004), Paris, 2006, § 4.
3 Cf. ibid., § 48.
4 Cf. Miguel Benasayag & Florence Aubenas, Résister, c’est créer, Paris, 2008.
5 Idée empruntée à l’artiste, email du 22/10/2024. Cf. McKenzie Wark, op. cit., § 130.
6 Formule empruntée à l’artiste www.nicolasboulard.com/grands-crus-de-grand-cru/
7 McKenzie Wark, op. cit., § 125.
8 Nicolas Boulard, Monde actuel, Clamart, 2024, n. p.
9 Cf. Gustave Geffroy, Images du jour et de la nuit, Paris, 1924, p. 116.
Texte écrit en 2024 dans le cadre de la bourse Ekphrasis lancée par l’ADAGP en association avec l’AICA France et Le Quotidien de l’Art
Paru dans le Quotidien de l’art du 9 janvier 2025